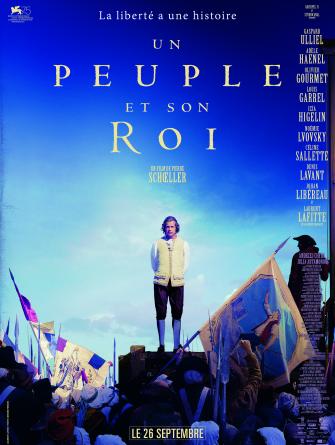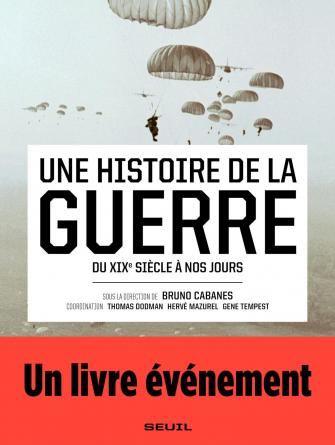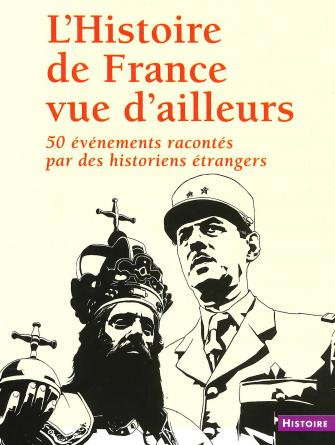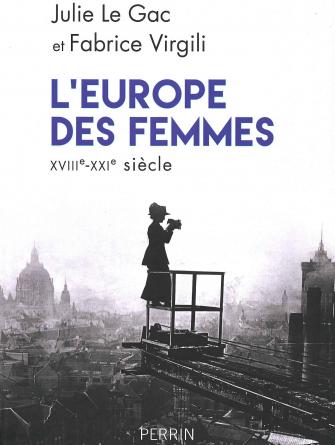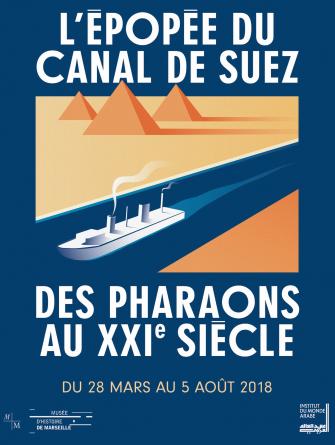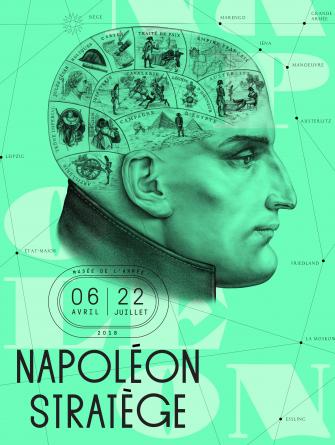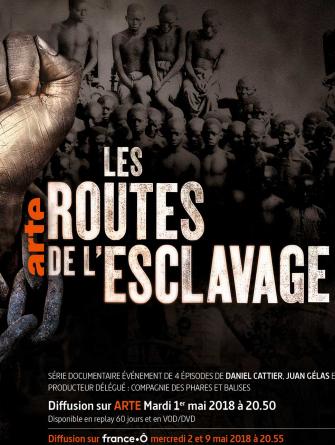Il était une fois la Révolution
Le cinéaste Pierre Schoeller livre une chronique de la Révolution française vue depuis une maisonnée d’habitants du faubourg Saint-Antoine. Le film débute le 14 juillet 1789, mais, par un amusant parti pris, la prise de la Bastille toute proche, est hors champ et n’est perceptible que par la rumeur du tumulte de l’assaut. Il se clôt le 21 janvier 1793, avec l’exécution de Louis XVI sur la place de la Révolution. Entre ces deux dates, le spectateur assiste au déroulement des événements révolutionnaires vus à hauteur d’homme.
Le travail de documentation et de reconstitution est absolument remarquable. Visuellement, bien des scènes du film rappellent les gravures ou les toiles d’époque telle cette belle scène de démolition de la Bastille. À mesure que les ouvriers descellent et font tomber les blocs de pierre des remparts, le soleil jusqu’ici masqué par l’imposante forteresse royale se dévoile aux habitants du faubourg en contrebas. Au-delà de sa symbolique, la scène semble tout droit inspirée du tableau d’Hubert Robert ou de la gouache de Lesueur conservés au musée Carnavalet. Mais la reconstitution est aussi sonore car les chansons populaires occupent une place importante dans le film en rythmant aussi bien les grands événements que les gestes du quotidien.
Un Peuple et son roi fait la part belle aux femmes en tant qu’actrices de la Révolution, qu’elles soient lavandières brocardant le roi sur les quais de la Seine, spectatrices des débats à l’Assemblée ou faisant le coup de feu durant la prise des Tuileries. Mais allant plus loin, par petites touches, le film donne à voir ce que peut être une vie de femme du peuple au XVIIIe siècle, entre travail quotidien, amours, sociabilités, naissances mais aussi décès d’enfants.
Extrêmement didactique, le film est entrecoupé de cartels qui précisent les différents tableaux révolutionnaires ou identifient les protagonistes, notamment lors du jugement du roi. On pourra juste s’étonner que les massacres de septembre ne soient que très pudiquement évoqués au détour d’une conversation, compte tenu du degré d’engagement des protagonistes dans les événements révolutionnaires.
Un Peuple et son roi offre une illustration parfaite du cours consacré à la Révolution française en classes de 4e et au lycée. De véritables morceaux de bravoure cinématographiques comme le retour de Varennes filmé depuis l’intérieur du carrosse royal ou l’impressionnante exécution du roi ne manqueront pas de marquer les esprits des élèves.
Informations
- Réalisateur : Pierre Schoeller
- 121 minutes
- 2018
Tout sur ma guerre
Tel un bataillon de Red Devils tombé du ciel pile sur l’objectif, les 800 pages d’Une Histoire de la guerre sont d’une redoutable efficacité. L’objectif de cet ouvrage est en effet de rendre compte du phénomène guerrier, à la fois fait social total et acte culturel, dans tous ses aspects. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est accomplie !
Centré sur les XIXe, XXe t XIXe siècles, des guerres de la Révolution et de l’Empire à la guerre civile syrienne, l’ouvrage montre comment on est progressivement passé à la guerre moderne – caractérisée par la massification des armées, l’idéologisation des combattants, l’effacement de la frontière civil/combattant et l’augmentation des capacités destructrices des armements – puis à la guerre postmoderne. Loin de l’histoire bataille d’antan, l’accent est mis sur la dimension humaine des conflits, les auteurs s’efforçant de comprendre l’expérience combattante tant du point de vue des soldats que de ceux qui les accompagnent ou subissent leur violence.
Constitué de 58 notices rédigées par une équipe internationale d’auteurs, le livre est organisé en quatre parties : la guerre moderne, mondes combattants, expériences de la guerre (du côté des soldats et du côté des civils) et sorties de guerre. En croisant les approches, il ouvre sur de multiples dimensions : histoire des émotions (le deuil, les névroses de guerre…), histoire sociale (les officiers, les femmes…), histoire de l’art (Goya et les désastres de la guerre…), économie (le financement de la guerre, la reconstruction…), environnement, etc. Chaque notice est assortie d’une bibliographie commentée.
Par ses multiples approches, ce volumineux opus apporte bien des éléments éclairants pour évoquer l’expérience combattante, la guerre d’anéantissement ou la guerre totale en classe de 1re et de 3e bien sûr, mais aussi les guerres révolutionnaires ou de l’âge industriel en classe de 4e, les guerres coloniales en classe de 1re ou encore la question des mémoires des conflits en classe de Tle. Cette somme chorale est absolument passionnante.
Informations
- Bruno Cabanes (dir.)
- Éditions du Seuil
- 2018
- 800 p., 32 €
Leurs ancêtres les Gaulois
Alors que la question du « récit national » revient régulièrement sur le devant de la scène, signalons la parution en poche du sémillant ouvrage de Jean-Noël Jeanneney et Jeanne Guérout initialement paru aux éditions des Arènes. Ce petit livre permettra assurément d’enrichir les débats.
Les deux historiens ont en effet rassemblés une équipe d’historiens étrangers pour évoquer 50 grandes dates de l’histoire de France, sorte d’étapes obligées des manuels scolaires et des chronologies. Il est assez rafraichissant de découvrir comment une historienne australienne traite la mort de Saint Louis, un Allemand évoque la bataille de Valmy à partir de sources littéraires prusso-allemandes ou quelle est la vision d’un Marocain sur l’Exposition coloniale de 1931.
Si certains auteurs sont, en quelque sorte, attendus sur une question (une historienne britannique sur la mort de Jeanne d’Arc, Gerd Krumeich sur la bataille de Verdun, Robert Paxton sur l’entrevue de Montoire), d’autres regards sont plus surprenants telle cette historienne japonaise traitant de la défaite de Diên Biên Phu ou ce professeur canadien évoquant le discours de De Gaulle à Phnom Penh.
Ce regard extérieur sur l’histoire de France ne manque pas d’apporter quelques surprises. On pourra juste regretter la faible part dévolue aux historiens africains et asiatiques ainsi que l’absence de voix latino-américaines.
Informations
- Jeanne Guérout et Jean-Noël Jeanneney (dir.)
- Éditions du Seuil, coll. Points Histoire
- 2018
- 448 p., 11 €
Un Européen sur deux est une femme
Depuis quelques décennies, les études historiques se sont intéressées au rôle et à la place des femmes dans l’histoire, ce dont les programmes scolaires se font l’écho (classes de 4e, de 3e et de 1re notamment).
La parution de L’Europe des femmes, coordonnée par Julie Le Gac et Fabrice Virgili, offre un outil formidable en présentant un riche corpus de documents célèbres ou totalement inattendus afin d’étudier l’histoire des femmes en Europe. Classé par entrées thématiques (devenir femme, la guerre, la politique, le corps des femmes, l’art, l’éducation etc.), cet ensemble de près de 80 textes ou iconographies est commenté par des chercheurs et universitaires. Petite originalité, les textes sont proposés dans leur langue originale et en français !
Si les figures de Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Anne Frank, Florence Nightingale ou Alexandra Kollontaï nous sont familières, d’autres, telle cette député-paysanne turque ou Fifi Brindacier, sont plus étonnantes. Du XVIIIe siècle à nos jours, la suffragette britannique, la militante républicaine espagnole, la tireuse d’élite soviétique, la députée italienne, la paysanne grecque ou l’ouvrière allemande tout comme la petite robe noire de Coco Chanel ou le mannequin anatomique d’accouchement de madame du Coudray précisent la géographie d’un continent souvent mal connu, l’Europe des femmes.
Informations
- Julie Le Gac et Fabrice Virgili (coord.)
- Éditions Perrin
- 2017
- 352 p., 23,5 €
Pharaonique !
1869 : le canal de Suez est inauguré avec faste par le khédive Ismaïl Pacha en présence du Gotha européen. Le titanesque projet de Ferdinand de Lesseps concrétise par un ouvrage d’art moderne une voie de communication envisagée dès l’Antiquité par les pharaons ou les souverains perses (suivant un tracé différent cependant), puis au XVIe siècle par les Vénitiens.
C’est cette réalisation cyclopéenne, à l’image des pyramides de Gizeh, que retrace l’exposition de l’Institut du monde arabe en présentant maquettes de l’ouvrage, sculptures, tableaux et photos des acteurs ou du chantier, extraits de films ou de discours. L’exposition insiste évidemment sur le travail herculéen réalisé par les milliers d’ouvriers égyptiens qui creusèrent à la pioche l’isthme de Suez, parfois au prix de leur vie.
Projet universel, le canal est alors propriété de capitaux français et égyptiens avant que la Grande-Bretagne ne s’y intéresse et acquière les parts de l’Égypte. Dès lors le canal de Suez devient un enjeu stratégique et cristallise le sentiment national égyptien. La nationalisation du canal par Nasser en 1956, illustré par le fameux discours du raïs qui résonne dans l’une des salles de l’exposition, marque le début d’une ère nouvelle pour l’Égypte.
Nœud stratégique de la géopolitique et du commerce mondial, le canal doit s’adapter à l’explosion du transport maritime et à l’augmentation du tonnage. C’est l’objectif des travaux de modernisation et d’élargissement entrepris par l’Égypte pour s’adapter aux défis du XXIe siècle.
Déroulant plusieurs siècles d’histoire, l’exposition de l’IMA offre une illustration parfaite pour aborder la question des rapports de l’Europe avec le monde au XIXe siècle en classe de 4e ou celle du Proche et du Moyen-Orient comme foyer de conflits en classe de Tle. Des pans entiers de l’exposition pourront aussi enrichir un cours de géographie consacré aux dynamiques de la mondialisation.
Informations
- Institut du monde arabe, Paris
- 28 mars-5 août 2018
- Musée d’histoire de Marseille
- Rentrée 2018
Échec et mat en Europe
Exposer les grands principes stratégiques qui ont guidé l'ation militaire et politique de Napoléon. Tel est l’ambitieux objectif de la nouvelle exposition du musée de l’Armée.
Utilisant l’outil que constituait l’armée française, héritière de l’Ancien Régime mais profondément transformée par l’introduction de la conscription révolutionnaire, Napoléon enchaîne les victoires à travers l’Europe. Prônant l’offensive et le mouvement, ciblant la capitale ennemie pour désorganiser l’adversaire et le forcer à accepter ses conditions de paix, Napoléon est reconnu comme le « Dieu de la Guerre », selon le mot de Clausewitz.
Réunissant cartes d’état-major, tableaux de batailles, uniformes et armes, livres parfois annotés par Bonaparte lui-même, drapeaux et aigles victorieux ou défaits, l’exposition réussit le pari de rendre tangible la pensée stratégique de Napoléon. Au fil des salles du musée, de nombreux dispositifs multimédias permettent au visiteur de s’essayer à des kriegspiel historiques.
Enfin, l’exposition n’oublie pas les adversaires de l’empereur et présente l’évolution de leur propre pensée stratégique afin de comprendre les causes de la défaite et de la chute de du Premier Empire.
Une visite enrichissante pour mieux comprendre les bouleversements opérés par les conquêtes napoléoniennes en Europe étudiés en classe de 4e et de 2de.
Informations
- Musée de l'Armée, Paris
- 6 avril-22 juillet 2018
- https://www.youtube.com/watch?v=gPN5xUoqs04
Soumis par admin le jeu, 06/21/2018 - 11:44
Voyage au bout de l'enfer
En 4 épisodes, la série documentaire Les Routes de l'esclavage coproduite par la chaîne Arte évoque l’histoire dramatique des traites négrières depuis le début du Moyen Âge : traites africaines, traite arabo-musulmane, explorations portugaises et insertion dans les circuits commerciaux africains, mise en place par ces mêmes Portugais du modèle économique de la plantation, traite transatlantique pratiquée par les puissances européennes, importation du système de plantation dans les Caraïbes et l’Amérique du Nord, naissance et développement du mouvement abolitionniste, résistances…
Ce documentaire donne une vue d’ensemble polyphonique à la fois passionnante et terrifiante de l’histoire des esclavages. Des historiens français, portugais, brésiliens, états-uniens, tanzaniens, maliens etc. décortiquent les mécanismes de ce système effroyable, réfutant bien des idées reçues.
Illustrée par des séquences d’animation sobres et élégantes, la série constitue une porte d’entrée idéale pour l’étude des traites négrières au XVIIIe siècle en classe de 4e.
Informations
- Série documentaire française
- Réalisateurs : Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant
- 4 films de 52, 52, 53 et 54 minutes
- 2018
Soumis par contributeur le lun, 05/28/2018 - 10:56
Soumis par contributeur le lun, 05/28/2018 - 10:56