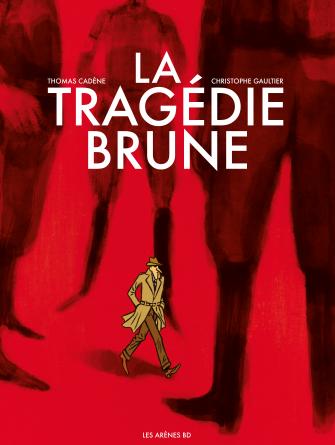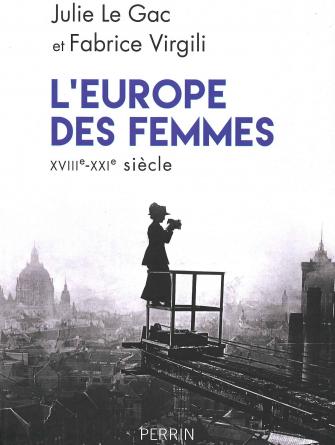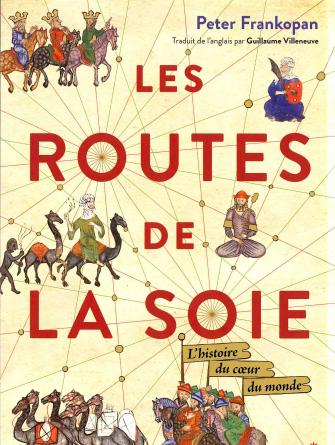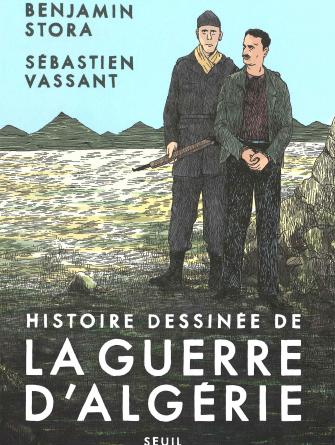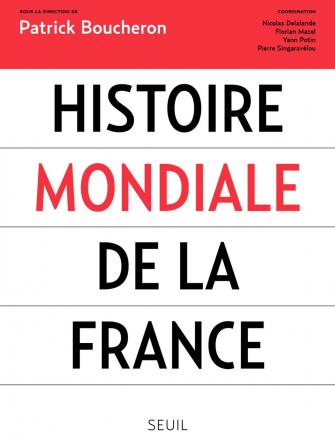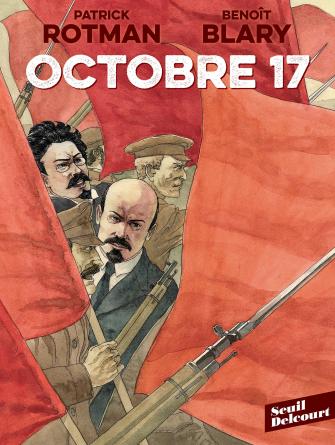« Si tu nommes le diable, il arrive en courant » (proverbe allemand)
Les éditions des Arènes ressuscitent Xavier de Hautecloque dans cet élégant album de BD porté par le trait clair de Christophe Gaultier, adaptation par Thomas Cadène de l’ouvrage éponyme paru en 1934.
Issu d’une vieille famille aristocratique, cousin germain du futur maréchal Leclerc, germanophone, un peu aventurier et probablement aussi un peu agent de renseignement, le personnage est singulier. Journaliste à l’hebdomadaire pamphlétaire Gringoire, Xavier de Hautecloque effectue plusieurs reportages en Allemagne, notamment à la veille de l’accession d’Hitler à la chancellerie et des élections de mars 1933 qui donnent plus de 43 % des voix au NSDAP. En octobre 1933, son rédacteur en chef lui demande de couvrir les nouvelles élections qui doivent avoir lieu en novembre.
Pugnace, de Hautecloque observe, investigue, dissèque les discours et traque la vérité derrière les silences et les non-dits. Décrivant la chape de plomb qui s’abat sur l’Allemagne en quelques mois, le reporter dénonce avec clairvoyance la menace que représente Hitler et pressent la guerre à venir. Il dresse un tableau effarant d’un pays où les opposants disparaissent subitement sans que personne ne fasse mine de le remarquer, où ceux qui ne sont pas avec les nazis sont des traîtres, où les mendiants et prostituées sont envoyés manu militari travailler à la campagne, où les détenus des premiers camps de concentration votent en majorité pour les nazis de peur d’encourir davantage de brimades, etc.
Portrait glaçant d’une société qui plonge dans les ténèbres, cette adaptation de La Tragédie brune permet de mieux comprendre la montée foudroyante du nazisme. Elle éclaire l’étude des totalitarismes en classe de 3e ou de 1re en montrant combien certains, en France, ont su percevoir la nature méphistophélique du nazisme. Parfois au prix de leur vie puisque Xavier de Hautecloque, décidément trop lucide, fut empoisonné par les services secrets nazis en 1935, peu de temps après la parution de son livre.
Informations
- Thomas Cadène (texte) et Christophe Gaultier (dessin)
- Les Arènes
- 2018
- 130 p., 20 €
Blitzkrieg sur les mythes
Les événements ou les figures de la Seconde Guerre mondiale sont connus. Pourtant Les Mythes de la Seconde Guerre mondiale, dirigé par Jean Lopez et Olivier Wieviorka, tout juste sorti en édition de poche, parvient à apporter un parfum de nouveauté. Tels des fact checkers ou autres décodeurs, une vingtaine d’historiens s’emparent d’une idée répandue sur le conflit et la contrecarrent, la corrigent ou la nuancent, chiffres et auteurs spécialistes à l’appui.
Selon son degré de connaissance du conflit, le lecteur découvrira que Churchill était loin de disposer du soutien unanime des Britanniques au début de la guerre ; que l’absurdité stratégique des kamikazes était surtout une stratégie de communication pour maintenir la cohésion sociale d’une société au bord de la rupture ; que l’existence de « féodalités » et d’un clientélisme effréné au sein du régime nazi, notamment dans le domaine économique, ont rendu bien difficile la mobilisation centralisée de l’industrie allemande ou encore que c’est plutôt la conquête foudroyante de la Mandchourie par l’Armée rouge que les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki qui conduisent le Japon à capituler.
Place des femmes dans la guerre, réévaluation de figures militaires ou politiques célèbres, impact réel d’une stratégie ou d’une campagne : 23 questions sont passées en revues par les auteurs. Cette entreprise de déconstruction des « mythes », parfois forgés par les vainqueurs ou les vaincus eux-mêmes, permettra de renouveler l’enseignement de la Seconde Guerre mondiale en classe de 3e et de 1re notamment.
Informations
- Jean Lopez et Olivier Wieviorka (dir.)
- Éditions Perrin, coll. Tempus
- 2018
- 446 p., 10 €
Un Européen sur deux est une femme
Depuis quelques décennies, les études historiques se sont intéressées au rôle et à la place des femmes dans l’histoire, ce dont les programmes scolaires se font l’écho (classes de 4e, de 3e et de 1re notamment).
La parution de L’Europe des femmes, coordonnée par Julie Le Gac et Fabrice Virgili, offre un outil formidable en présentant un riche corpus de documents célèbres ou totalement inattendus afin d’étudier l’histoire des femmes en Europe. Classé par entrées thématiques (devenir femme, la guerre, la politique, le corps des femmes, l’art, l’éducation etc.), cet ensemble de près de 80 textes ou iconographies est commenté par des chercheurs et universitaires. Petite originalité, les textes sont proposés dans leur langue originale et en français !
Si les figures de Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Anne Frank, Florence Nightingale ou Alexandra Kollontaï nous sont familières, d’autres, telle cette député-paysanne turque ou Fifi Brindacier, sont plus étonnantes. Du XVIIIe siècle à nos jours, la suffragette britannique, la militante républicaine espagnole, la tireuse d’élite soviétique, la députée italienne, la paysanne grecque ou l’ouvrière allemande tout comme la petite robe noire de Coco Chanel ou le mannequin anatomique d’accouchement de madame du Coudray précisent la géographie d’un continent souvent mal connu, l’Europe des femmes.
Informations
- Julie Le Gac et Fabrice Virgili (coord.)
- Éditions Perrin
- 2017
- 352 p., 23,5 €
Sur la route
C’est à un changement de perspective géographique que nous invite l’historien britannique Peter Frankopan, professeur d’Histoire globale à l’université d’Oxford. Plutôt que d’étudier l’histoire mondiale en adoptant la traditionnelle vision européocentriste focalisée sur le bassin méditerranéen, il déplace sont point de vue vers l’est et fait de l’Asie centrale le cœur de son étude du monde.
Ce vaste espace de passage, s’étendant des rives orientales de la Méditerranée à l’Himalaya, est traversé de couloirs de flux multiples d’hommes, d’idées, de produits manufacturés ou de ressources naturelles. Des acteurs jusqu’ici cantonnés aux marges de nos programmes scolaires parcourent ces « routes courant sur l’échine de l’Asie » : diadoques, Perses Sassanides, Khazars, peuples nomades de la steppe, Vikings rus’, khans Mongols, souverains Moghols ou Ottomans, compagnies de commerce européennes de la Vereenigde Oostindische Compagnie ou de l'East India Company ou encore soldats et explorateurs du Tsar. Quasi absentes de nos manuels d’histoire, les villes de Ctésiphon, Samarcande, Merv, Nishapur, Karakorum ou Luoyang reprennent leur place sur la carte. Les rapports entre puissances européennes puis entre superpuissances s’apprécient sous un autre jour à la lumière des enjeux commerciaux, stratégiques ou diplomatiques centre-asiatiques.
Foisonnant, cet ouvrage constitue un passionnant essai d’histoire globale.
Informations
- Peter Frankopan
- Titre original : The Silks Roads, A New History of the World
- Editions Nevicata
- 2017
- 736 p., 27 €
Des bulles de bruit et de fureur
Exposer la guerre d’Algérie en un roman graphique de quelques centaines de pages semble à première vue tenir de l’exploit. C’est pourtant le défi relevé par l’historien Benjamin Stora et le dessinateur Sébastien Vassant.
S’appuyant sur le dessin simple, parfois un peu caricatural et volontiers ironique de l’artiste, l’ouvrage expose avec une clarté éclatante le déroulement de la guerre d’Algérie. Racines du conflit, genèse du nationalisme algérien, déroulé des événements en Algérie comme en France, entrecoupés de témoignages d’acteurs français ou algériens éclairant le propos donnent une synthèse lumineuse de ce conflit à la fois guerre coloniale, guerre de libération, guerre civile entre Français et guerre civile entre Algériens.
De lecture facile, cette bande dessinée constitue une porte d’entrée idéale, notamment pour présenter le contexte du chapitre consacré aux mémoires de la guerre d’Algérie en Tle.
Informations
- Benjamin Stora et Sébastien Vassant
- Editions du Seuil
- 2016
- 192 p., 24 €
Monument national
Sous la direction de Patrick Boucheron, 122 historiens brossent en 146 dates, parfois assez inattendues (le mariage d’Henri Ier avec Anne de Kiev en 1051, la traduction des Mille et Une Nuits par Galland en 1712, la révolte kanak en 1917, le lancement du parfum Channel n°5 par Coco Channel en 1921) et résultant d’un choix éclectique, une nouvelle histoire de France.
Dépassant les limites de notre « hexagone », l’ouvrage propose une analyse décalée d’événements familiers, insiste sur les interactions ou les influences extérieures, et offre une vision renouvelée et plurielle de l’histoire de France.
Si l’on oublie les polémiques entre tenants de l’histoire mondiale et partisans d’une histoire plus classique ou traditionnelle, cet épais manuel constitue une lecture passionnante qui ne pourra qu’attiser la curiosité des enseignants ou des amateurs d’histoire.
Informations
- Patrick Boucheron (dir.)
- Éditions du Seuil
- 2017
- 800 p., 29 €
Le 9e Art au pays des Soviets
Centenaire de la révolution russe oblige, l’actualité des publications consacrées à la question est chargée. On notera cette initiative associant le documentariste Patrick Rotman et le dessinateur Benoît Blary, qui livrent un documentaire en BD reconstituant minutieusement les événements révolutionnaires, puis ceux du fatidique mois d’octobre 1917, qui vit la révolution bolchevique balayer la révolution de février.
Lénine et Trotski bien sûr, Staline, Kerenski, mais aussi John Reed, Maïakovski ou Alexandra Kollontaï apparaissent sous le dessin sage et élégant de Benoît Blary. Au-delà des personnalités connues, le destin de quelques figures anonymes, marins ou ouvriers, permet de donner corps à l’histoire.
Claire et didactique, agrémentée de plans et de cartes, cette bande dessinée permet de saisir précisément la chronologie de cette révolution qui allait changer non seulement la Russie, mais aussi la face du monde.
Informations
- Benoît Blary et Patrick Rotman
- Éditions du Seuil/Delcourt
- 2017
- 112 p., 17,95 €