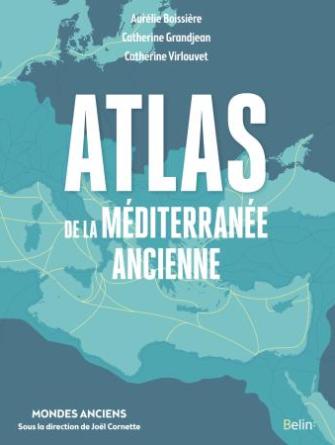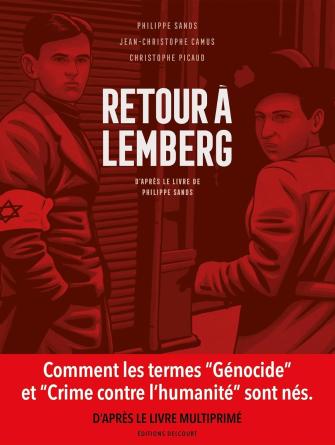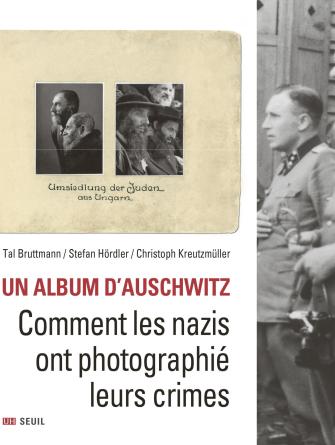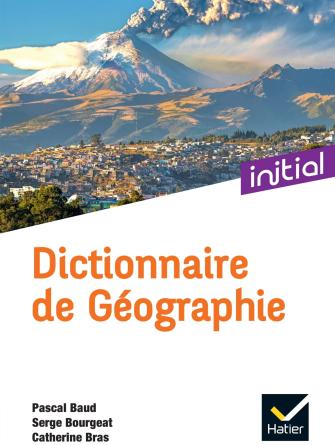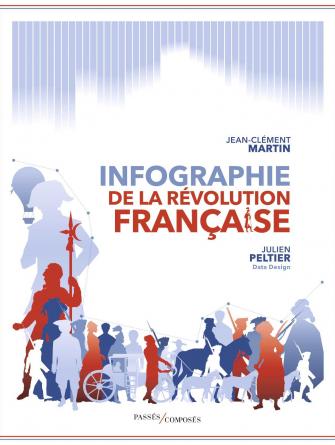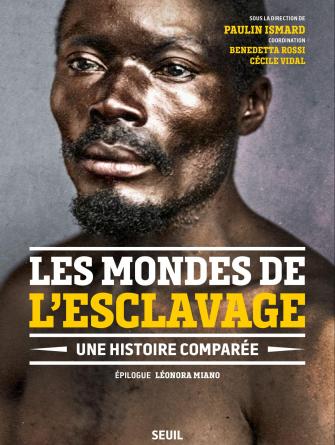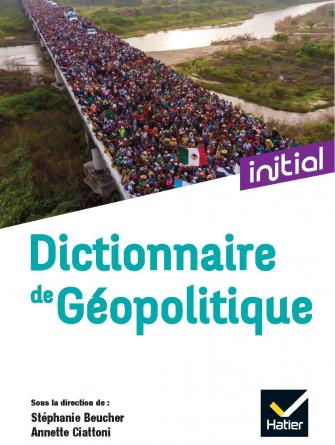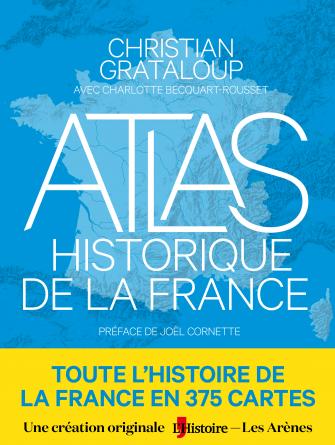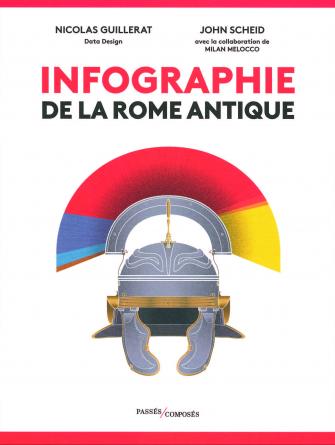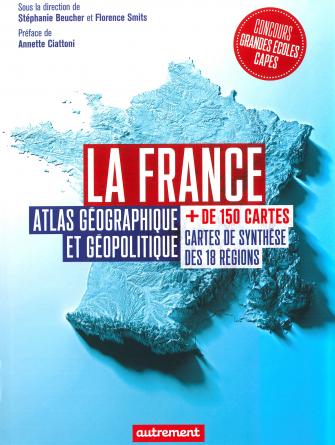Beau comme l’Antique !
Les éditions Belin sont à l’origine de la formidable collection Mondes anciens, consacrée aux civilisations anciennes. S’appuyant sur la quinzaine de titres de la collection, elles proposent un atlas consacré à la Méditerranée antique, rassemblant des cartes extraites des différents volumes traitant de l’Égypte, de la Mésopotamie, du Proche-Orient, de la Grèce, de Rome et du monde hellénistique.
L’ouvrage est découpé en six thématiques (le creuset méditerranéen ; cités, empires, royaumes ; guerres et batailles ; économies et circulations ; cultures et religions ; monuments et trames urbaines). Introduites et contextualisées par deux historiennes de l’Antiquité, quelques 300 cartes permettent d’étudier un même phénomène à travers plusieurs civilisations.
La variété des échelles permet de circuler du plan d’une cité à l’ensemble du monde méditerranéen. La richesse et la transversalité de l’ouvrage offre aux enseignants la possibilité de construire à leur gré des dossiers originaux traitant de lieux moins couverts par les manuels, des cités-États de Mésopotamie aux colonies grecques d’Asie Mineure ou de Grande Grèce. Ce très bel ouvrage séduira enfin les amateurs d’Antiquité qui pourront rêver en parcourant le réseau des voies romaines ou en recensant les fondations grecques d’Asie centrale.
Informations
- Aurélie Boissière
- Catherine Grandjean
- Catherine Virlouvet
- Éditions Belin
- 2025
- 512 p., 35 €
Le monde d’hier
La parution en bande dessinée d’une adaptation de l’ouvrage de Philippe Sands Retour à Lemberg met aisément à la portée des lycéens un ouvrage particulièrement utile pour illustrer les programmes d’Histoire et d’HGGSP de Tle, notamment les thèmes consacrés aux violences de masse durant la Seconde Guerre mondiale et aux rapports entre histoire et mémoires.
Professeur de droit international, fin connaisseur des tribunaux internationaux, Philippe Sands est invité en 2010 à donner une conférence à la faculté de droit de Lviv en Ukraine sur les travaux concernant le génocide et le crime contre l’humanité. C’est pour lui l’occasion d’un retour aux origines, puisque son grand-père, Leon Buchholz, était originaire de cette ville, l’ancienne Lemberg austro-hongroise, devenue Lwow dans la Pologne de l’entre-deux-guerres puis Lvov sous l’occupation soviétique et redevenue Lemberg sous l’occupation nazie. Sands relève que Raphael Lemkin, juriste en droit international pénal, inventeur du concept de génocide, et Hersch Lauterpacht, développeur de la notion de crime contre l'humanité, ont eux aussi habité la cité au début du XXe siècle.
Ce retour aux sources est pour le juriste franco-britannique l’occasion d’une minutieuse enquête sur son grand-père, décédé dans les années 1990 et mutique sur les circonstances qui l’ont conduit à quitter sa terre natale. Au fil de son enquête, Sands reconstitue la vie de cet homme, en parallèle à celles de Lemkin, de Lauterpacht mais aussi de Hans Frank, le sinistre gouverneur général de la Pologne occupé par les nazis qui vécut lui aussi à Lemberg. Réunissant les pièces d’un puzzle qui s’assemble peu à peu, Sands plonge dans son histoire familiale, tissant des parallèles entre ces hommes, polyglottes, héritiers de l’Autriche-Hongrie des Habsbourgs, bientôt exilés. Emportés dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale et du délirant projet génocidaire nazi, Lemkin et Lauterpacht élaborent et développent les concepts qui permettront de punir les criminels nazis lors du procès de Nuremberg. Au fil de l’enquête de Sands, de Lemberg à Nuremberg, les fils des destins des quatre hommes se croisent et se recroisent alors que disparaît la Mittel Europa cosmopolite qui les a vus naître.
Informations
- Jean-Christophe Camus (scénario)
- D’après Philippe Sands
- Christophe Picaud (dessin)
- Éditions Delcourt
- 2024
- 304 p., 34,95 €
Comment les nazis ont photographié leurs crimes
La parution récente d’Un Album d’Auschwitz, Comment les nazis ont photographié leurs crimes offre un passionnant regard sur le travail de l’historien. Une équipe de trois historiens français et allemands, spécialistes du génocide, s’est attelée à décortiquer l’«album d’Auschwitz». Cet album rassemble 197 photographies pour la plupart prises par les SS pour documenter la mise en œuvre de la déportation à Auschwitz-Birkenau des Juifs hongrois entre mai et juillet 1944. Ce document a été découvert à la fin de la guerre par Lili Jacob, une déportée hongroise rescapée des camps, qui y a reconnu des membres de sa propre famille et de sa communauté. Après avoir servi de preuve lors de différents procès des criminels après-guerre, l’album a été remis au Mémorial de Yad Vashem en 1980.
Il s’agit donc d’un document historique à la fois connu ‒ certaines photographies ont acquis le statut d’icône et sont largement reproduites notamment dans les manuels scolaires ‒ et méconnu ‒ d’autres images, souvent plus difficiles à lire, sont plus confidentielles ou ont été mal attribuées à la suite d’erreurs de légende.
Dans une première partie, l’ouvrage expose l’organisation et le déroulement du «programme Hongrie» de déportation des Juifs de ce pays. Puis il retrace le parcours de Lili Jacob et la façon dont elle récupéra l’album de photos. Il se tourne ensuite vers les deux photographes SS du Service anthropométrique du camp, Bernhard Walter et Ernst Hofmann, qui prirent l’ensemble des clichés afin de constituer un document pour leur propre hiérarchie.
Les deuxième et troisième parties exposent un fac-similé de l’album puis une analyse minutieuse des différentes photos, classées par thèmes. Les historiens traquent les indices : ici un numéro de wagon, là un individu précisément identifié, ailleurs un détail de vêtement ou d’uniforme ou encore un geste. Dans un passionnant exercice de lecture des images, celles-ci sont croisées avec les témoignages des survivants et la littérature scientifique, replacées dans la géographie du camp et la chronologie du processus de transport, de sélection et d’assassinat des déportés. Les historiens décortiquent l’angle des prises de vues pour mieux faire comprendre ce que l’on voit. Mais ils détaillent aussi parfois ce que l’on ne voit pas, exposant les intentions des photographes, y compris artistiques, explicitant les biais racistes de certains clichés. Ils reconstituent enfin des séries, réunissant des photos ventilées dans différentes parties de l’album, et permettant de comprendre le processus d’extermination à l’œuvre, voire de suivre certains individus pour un court instant.
À la fois passionnant et bouleversant, cet ouvrage constitue un formidable outil de documentation pour éclairer le processus de destruction des Juifs d’Europe en classe de 3e et de Tle.
Informations
- Tal Bruttmann
- Stefan Hördler
- Christoph Kreutzmüller
- Éditions du Seuil
- 2023
- 304 p., 49 €
Le monde ne suffit pas
Qu’est-ce que le concept de transition ? Qui était Vidal de La Blache ? Comment se forme un tombolo ? Qu’appelle-t-on la marbellisation ? Comment est calculé l’indice de pauvreté en eau ? La géographie sert-elle vraiment à faire la guerre ? Qu’est-ce qu’une carte piézoplèthe ? Autant d’interrogations que l’enseignant ou l’étudiant en géographie peut être amené à se poser au détour d’un cours, d’un article, d’un devoir ou d’une conversation. Mais il est parfois difficile de trouver rapidement une réponse claire et pertinente.
La nouvelle édition du Dictionnaire de géographie des éditions Hatier, entièrement refondue et actualisée, permet d’accéder facilement à la définition de termes précis, mais aussi à des mises au point sur les grandes notions et thématiques de la géographie. Divisée en 59 articles, tous les aspects de la discipline sont abordés : géographie physique bien sûr, mais aussi géopolitique, géographie humaine classique, géographie culturelle, sociale ou économique. Un lexique de plus de 4 300 termes permet de retrouver immédiatement les termes contextualisés. Ce petit dictionnaire de poche est un usuel de premier ordre pour les enseignants et les étudiants.
Informations
- Pascal Baud
- Serge Bourgeat
- Catherine Bras
- Hatier
- 2022
- 624 p., 14,90 €
Les infographies de l’an II
L’infographie historique a le vent en poupe. Après Infographie de la Seconde Guerre mondiale, aux éditions Perrin en 2018, puis Infographie de la Rome antique en 2020, les Éditions Passés composés persistent et signent avec un nouveau volume consacré à la Révolution française.
Présentées par l’historien Jean-Clément Martin, une série de notices consacrées à la marche de la Révolution, aux grands bouleversements qui en découlent puis aux conflits qu’ils provoquent sont éclairées par des bataillons d’infographies, cartes, frises ou données chiffrées, alliant récit et modélisation. Des plans en perspective isométrique permettent de suivre certains événements révolutionnaires, tels la prise de la Bastille ou l’assaut des Tuileries, afin de mieux comprendre leur déroulement ou leur inscription dans l’espace. Des frises comparées exposent l’attitude des différents protagonistes ou courants d’opinion au fil des événements. Passant du général au particulier, une multitude de données chiffrées, mises en lumière par le data designer Julien Peltier, permettent de mieux saisir l’ampleur des massacres de septembre à Paris, la composition de l’armée de Valmy, la place des femmes dans l’espace public ou encore l’origine des sans-culottes parisiens.
Au-delà de l’effet de mode, ce traitement – révolutionnaire serait-on tenté de dire – renouvelle la lecture des événements de 1789 à 1799 par le prisme de la data visualisation. Au gré de leur exploration de ce beau volume, les professeurs pourront trouver matière à nourrir ou enrichir leur enseignement de la période révolutionnaire en classes de 4e et de 2de.
Informations
- Jean-Clément Martin
- Julien Peltier (data design)
- Éditions Passés composés
- 2021
- 128 p., 27 €
La condition inhumaine
Véritable somme de plus d’un millier de pages, Les Mondes de l’esclavage propose une histoire globale et comparée de l’esclavage depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Rassemblant une équipe d’une cinquantaine d’auteurs, historiens, archéologues, juristes ou anthropologues de 15 nationalités différentes, l’ouvrage entend montrer la multiplicité des situations esclavagistes selon les configurations historiques.
L’ouvrage s’articule en 3 parties. Dans un premier temps, une cinquantaine de notices brossent une histoire mondiale du fait esclavagiste, multipliant les situations étudiées comme autant d’études de cas, du marché aux esclaves de Chios à ceux du monde viking, des caravanes transsahariennes à l’Égypte des Mamelouks, de la Côte des Esclaves aux plantations de la Barbade et de la Jamaïque au XVIIIe. L’une des notices notamment, propose une passionnante histoire « en creux » des quelques milliers d’esclaves noirs présents dans la France métropolitaine du XVIIIe, à partir de traces aléatoires trouvées dans les papiers de leurs maîtres.
Dans une deuxième partie, la perspective comparatiste permet d’éclairer réciproquement les sociétés étudiées. L’étude de 26 notions ou concepts (Traite, Violence, Travail, Affranchissement mais aussi Genre ou, plus surprenant, Esclavage volontaire) met en relief similitudes et particularités.
Enfin, une dernière partie propose l’analyse de grandes ruptures transformatrices des sociétés esclavagistes, d’un point de vue religieux, philosophique, économique ou politique.
Riche et nuancé, cet imposant ouvrage offrira de nombreuses ressources aux enseignants, notamment pour l’enseignement de la traite atlantique en classe de 4e mais aussi pour étudier l’esclavage antique en classe de 6e ou la Méditerranée médiévale en 2de.
Informations
- Paulin Ismard (dir.)
- Éditions du Seuil
- 2021
- 1 168 p., 29,90 €
Le jeu des trônes
La géopolitique a le vent en poupe. La récente création d’une spécialité en classe de 1re et de Tle traduit l’importance de cette discipline dans la façon d’appréhender et de comprendre le monde. Pour autant, la géopolitique est une discipline protéiforme. Elle fait appel à d’autres sciences pour étudier la dimension spatiale des faits politiques : géographie bien sûr, mais aussi sciences politiques, économie, histoire, etc. Ce dictionnaire offre justement cette approche multiple, réunissant des auteurs issus de toutes ces disciplines. Alternant articles longs de plusieurs pages, notices ou courtes définitions, l’ouvrage entend rendre compte des multiples facettes de la géopolitique.
De nombreuses entrées composites permettent de croiser les approches : espaces (Sahel, Antarctique, Amazonie, Caraïbe…), entités politiques (États-Unis, Allemagne, Japon, Chine…), notions ou concepts chers à l’histoire, à la sociologie ou à la géographie (identité, émergence, interface, genre…). Près d’une centaine de cartes illustrent les articles pour donner une vision multiscalaire des jeux de pouvoir. De l’Indopacifique à Mourmansk, des territoires du cyberespace aux réseaux de la criminalité, de l’Empire ottoman au monde de Game of Thrones, elles offrent de multiples possibilités d’analyse et ou d’étude.
Varié, riche et parfois surprenant, ce petit dictionnaire ne devrait pas tarder à trouver sa place dans la bibliothèque de tous les enseignants et les lycéens de la spécialité HGGSP.
Informations
- Stéphanie Beucher (direction)
- Annette Ciattoni (direction)
- Hatier
- 2021
- 576 p., 14,90 €
Cartes sur table
Après un excellent et fort riche Atlas historique mondial, paru en 2019, Christian Grataloup récidive avec un Atlas historique de la France paru voici quelques mois. En près de 375 cartes, le géographe spécialiste de géohistoire déroule le film d’une « fabrique » de la France en cinémascope.
Dans la lignée du XIXe siècle, l’auteur s’attache aux différents portraits géographiques du territoire français. Étudiant la véritable icône nationale que constitue la carte de France, telle celle de Vidal de la Blache ou celle du Tour de la France par deux enfants, l’auteur s’interroge sur le roman national.
Puis le cœur de l’ouvrage rassemble des cartes issues du fond de la revue L’Histoire, allant de la pré-France au planisphère de son insertion dans le monde de 2020. Jouant avec les échelles, l’auteur alterne les coups de projecteurs (les protestants du XVIIe au XVIIIe siècle, les expéditions militaires de Napoléon III, la France de l’affaire Dreyfus, etc.) et les grandes étapes (Charlemagne, Louis XI, la Renaissance, la Révolution, la Grande Guerre etc.). Certaine ont d’étranges résonances contemporaines, telles ces cartes de la peste à Marseille et en Provence en 1720. D’autres étonnent telle celle de la diversité des toitures au XVIIIe.
L’auteur s’intéresse enfin aux usages du passé. De la carte des chantiers archéologiques de l’INRAP à celles de la légende napoléonienne, des mémoires industrielles ou des grands écrivains, Christian Grataloup s’interroge sur la patrimonialisation à l’œuvre depuis quelques décennies et sur la « passion de l’histoire » censée animer les Français.
Véritable malle au trésor pour l’enseignant de collège ou de lycée, cet Atlas historique de la France constitue une somme cartographique à se procurer de toute urgence.
Informations
- Christian Grataloup
- Charlotte Becquart-Rousset
- Les Arènes/L’Histoire
- 2020
- 320 p., 24,90 €
Infografix et les lauriers de César
Un vent nouveau souffle sur le Forum Romanum. Les éditions Passés composés viennent en effet de publier un ouvrage qui renouvelle l’approche de la Rome antique. Utilisant le procédé de la data visualisation le graphiste Nicolas Guillerat illustre en plusieurs centaines d’infographies l’histoire romaine, des débuts de la République jusqu’à la période impériale. Ici, une carte façon plan de métro retrace la révolte de Spartacus. Là, l’équipement d’un légionnaire de l’époque impériale est détaillé, pesé et étalé à plat, tel celui d’un Playmobil dans son blister. Là-bas une courbe illustre les besoins de Rome en blé rapportés à son histoire. Ailleurs, le système de la clientèle est décortiqué. Plus loin encore, une carte de l’Empire au premier siècle rend compte des densités de population.
Il faut rendre à César ce qui est à César : le travail de l’historien John Scheid pour collecter toutes ces données sur la période antique s’apparente à un véritable travail de… Romain, magnifiquement mis en forme par l’infographiste Nicolas Guillerat. Surprenantes, lumineuses, parfois amusantes, les infographies fournissent autant d’éclairages originaux sur la civilisation romaine.
Cette approche novatrice offrira aux professeurs, qu’ils soient latinistes distingués ou fans d’Alix l’intrépide, une multitude de documents étonnants pour enseigner l’Empire romain dans le monde antique en classe de 6e ou l’étude du Thème 1 sur l’empreinte romaine dans la Méditerranée antique en 2de.
Informations
- John Scheid
- Nicolas Guillerat (data design)
- Éditions Passés composés
- 2020
- 132 p., 27 €
Sous le signe de l’hexagone
On ne présente plus les atlas des éditions Autrement, véritables mines d’informations tant pour les enseignants que pour les curieux. L’atlas géographique et géopolitique de la France ne déroge pas à la règle. Riche d’environ 150 cartes et d’une bonne soixantaine d’infographies diverses et variées, il brosse un portrait de la France contemporaine en ce début de XXIe siècle. Découpé en huit parties, il présente la population française, l’environnement et le système urbain, les systèmes productifs, l’aménagement du territoire et ses acteurs, la place de la France dans le monde et se clôt par un panorama des 18 régions françaises métropolitaines et ultramarines.
Si les thématiques sont variées, des défis du vieillissement de la population à la question des pollutions et des déchets, en passant par la présentation des forêts, celle des ports de commerce ou encore des espaces de la contestation, cet atlas surprend par un éclairage souvent original. Ainsi cette étude des contrastes territoriaux liés à la santé illustrée par une infographie montrant l’indice de mortalité globale sur les différentes communes desservies par la ligne B du RER. Ou encore cette analyse des défis rencontrés par les villes moyennes à travers une carte de l’évolution de la vacance commerciale dans le centre-ville de Béziers.
Extrêmement riche, parfois surprenant, cet atlas donne une véritable radiographie de la France de 2020, celle des gilets jaunes comme celle de l’agriculture biologique ou de la couverture 4G. De Corte à Dunkerque, de Camaret à Chamonix, les enseignants y trouveront une foultitude de documents à toutes les échelles pour compléter ou renouveler leurs cours.
Informations
- Stéphanie Beucher (direction)
- Florence Smits (direction)
- Aurélie Boissière (cartographie)
- Éditions Autrement
- 2020
- 192 p., 29,90 €